Introduction
Présentation
Le développement de la « science des races » et son succès sont directement liés aux grandes découvertes et aux colonisations qui suivirent : le sentiment de supériorité de « l’homme blanc » légitime toute la démarche coloniale.
Le mot race apparaît au XVe siècle dans la langue française. Il s’applique en particulier à l’élevage et désigne un ensemble de caractéristiques communes reliant ascendants et descendants d’une lignée.
Ce n’est que plus tard, au XVIIe siècle, qu’il est appliqué à l’Homme. Le racisme dans sa forme moderne est né. Ses premières victimes seront les Indiens d’Amérique et les peuples d’Afrique décimés par les traites.
À la fin du XVIIIe siècle, les naturalistes Linné, suédois, puis Buffon, classent les hommes en grands groupes de races : blanche, noire, jaune et rouge. Classification forte de hiérarchies ultérieures.
Au début du XIXe siècle, l’anthropologie physique s’appuie sur l’anatomie comparée pour établir une prétendue « hiérarchie des races ». Les capacités d’un homme sont conditionnées à sa race.
Ce racisme scientifique (avant de devenir populaire) sert d’alibi à la colonisation. Ses répercussions sur la culture européenne et les relations sociales seront immenses. Pire, il fait sans le savoir le lit des grands génocides du XXe siècle.
Mieux comprendre pourquoi et comment a fonctionné le piège de la science des prétendues races est essentiel pour en prévenir les résurgences toujours possibles.
Qu’est-ce que la race ? (Lawrence Hirschfeld)
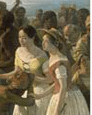
Lawrence A. Hirschfeld est professeur associé en anthropologie et en psychologie à University of Michigan. Dans un livre publié par MIT Press en 1998, il réfléchit sous ces deux angles. Race in the Making: Cognition, Culture and the Child’s Construction of Human Kinds est une synthèse des recherches menées par Hirschfeld aux Etats-Unis et en Europe sur le mode de pensée des enfants par rapport à la race. Cet ouvrage intéressera non seulement anthropologues, psychologues, philosophes, historiens, politologues et travailleurs sociaux, mais aussi parents et enseignants. Le professeur Hirschfeld a présenté certaines de ses conclusions au cours d’une entrevue accordée à John Woodford, de Michigan Today.
MT : Qu’est-ce que la race?
LH : Il est important d’expliquer d’abord ce que la race n’est pas. En dépit de ce que nos sens semblent nous indiquer, la race n’est pas un concept biologiquement cohérent pour expliquer la « variation humaine », tout simplement parce que cette race dont nous reconnaissons l’existence et que nous désignons telle-quelle ne représente pas une population biologiquement cohérente. En fait, la variation intraraciale est au moins aussi importante que la variation interraciale. Cela ne veut pas dire que la race n’existe pas au plan psychologique ou sociologique. Sur ces deux plans, la race est une réalité évidente. Les gens croient aux races et c’est sur cette croyance qu’ils structurent les dimensions importantes de leur vie, socialement, économiquement et politiquement. Mais cela ne fait pas de la race une réalité biologique.
Ainsi, il est plus sensé de voir la race comme une idée, pas comme une chose. Et de surcroît, d’après ce que nous savons de l’histoire des relations raciales, la race est une mauvaise idée. Maintenant, on déploie des efforts considérables pour se débarrasser de cette idée particulière afin de créer ce que l’on appelle parfois une société « sans couleurs ». Mais après 15 années de recherche sur la race vue comme idée, la conclusion que j’en tire, c’est que la race est non seulement une mauvaise idée, mais surtout une mauvaise idée profondément enracinée. Notre esprit semble être organisé de telle sorte que penser en fonction de la race – c’est-à-dire penser que le monde humain peut être segmenté en populations raciales discrètes [au sens mathématique] – s’inscrit presque automatiquement dans notre répertoire mental.
De fait, ma recherche suggère que l’idée de race a émergé d’une adaptation évoluée de l’appréhension de l’être humain en tant que membre faisant partie de groupes sociaux. Telle quelle, cette idée est sans doute difficile à enlever de nos têtes. L’interprétation raciale du mécanisme de la pensée n’est peut-être pas si éloignée de la réalité qu’elle n’en a l’air, si vous pensez à toutes les sortes de problèmes auxquels ont fait face nos ancêtres. Pour les membres d’une espèce dont l’existence était aussi sociale que la nôtre, l’enjeu consistait clairement à savoir précisément qui appartenait à tel groupe et pourquoi. Les individus qui possédaient ce savoir ou cette connaissance arrivaient mieux que quiconque à évaluer avec précision qui était le plus susceptible de poser une menace pour le groupe et qui était probablement inoffensif. Si la pensée raciale provient en partie de cette sorte d’adaptation, alors c’est une notion qui est effectivement très profondément enracinée.
MT : Selon vous, le racisme est-il inné et inévitable ?
LH : Certainement pas. Par contre, les structures qui donnent à l’être humain la capacité de mettre ensemble certains types de connaissances et de les structurer sont innées. Ces structures facilitent des conclusions selon lesquelles les gens ont en eux une nature essentielle héréditaire, et dans leur esprit, c’est cette nature qui engendre alors d’autres différences qualitatives, moins évidentes. Il faut également garder à l’esprit que les structures rendent possibles certains types de connaissances, mais en soi, elles ne sont pas porteuses de ces connaissances. Parallèlement, l’environnement culturel où nous vivons est aussi important. En ce sens, nous pouvons convenir que ces deux choses, l’esprit et la culture où se trouve l’esprit, se complètent.
Beaucoup d’entre nous ne sommes pas à l’aise avec cette conception. Notre esprit peine à imaginer qu’en marge de la culture apprise – nos influences sociales –, il puisse y avoir autre chose qui façonne des croyances à implications politiques, comme la race. De fait, on suppose généralement, malgré un manque de preuve dans ce sens, que l’on peut complètement changer le mode de pensée des gens en changeant l’environnement culturel où est ancrée la pensée. Or cette stratégie ne tient pas du tout compte de ce que l’esprit, « en tant qu’organe adapté », apporte au processus de construction des races.
Il est peut-être plus facile de comprendre tout cela en faisant une analogie avec des aspects du bon sens qui sont moins politisés. Par exemple, on sait aujourd’hui que la géométrie euclidienne et la mécanique newtonienne sont des descriptions imprécises du monde. Pourtant, nos intuitions basées sur le bon sens sont en adéquation avec la géométrie euclidienne et la mécanique newtonienne. En d’autres termes, le bon sens, voire le monde physique, sont bien décrits par ces systèmes de pensée. Nous pouvons certainement apprendre d’autres systèmes qui décrivent le monde physique, par exemple la géométrie riemannienne ou la physique quantique. Mais nous ne pouvons pas désapprendre le bon sens. Dans cette perspective, la race est comme la géométrie euclidienne. Nous pouvons comprendre que c’est une description imprécise du monde, mais cela ne veut pas dire qu’elle disparaîtra de notre arsenal conceptuel.
Ceci n’est pas sans conséquences sur ce que nous enseignons aux enfants à propos de la race. Lorsqu’on raconte aux enfants qu’à l’intérieur, nous sommes tous les mêmes et que la race, ce n’est pas important et que c’est vraiment une question superficielle, cela peut nous donner bonne conscience. Mais ce n’est probablement pas très efficace par rapport au mode de pensée des enfants. Il en est de même lorsqu’on dit aux enfants qu’ils ne devraient pas avoir de croyances raciales – des croyances selon lesquelles le monde est segmenté en groups raciaux discrets : ce genre de discours ne fait qu’accroître leur anxiété. Quand un adulte explique à des enfants que ce qu’ils pensent être bleu n’est pas bleu, cette contradiction crée de l’anxiété. Et ce n’est pas une bonne manière de faire évoluer une croyance. Arriveriez-vous à convaincre quelqu’un de perdre du poids si vous vous contentiez de lui dire qu’il n’a pas faim ?
MT : Cela a-t-il des implications pour ce qu’un enfant ressent par rapport aux membres des autres groupes ?
LH : Oui. Des études montrent que dès l’âge de 3 ans, l’enfant s’est déjà forgé des attitudes très négatives par rapport aux membres des exogroupes. Pour beaucoup, l’enfant apprend ce type d’attitudes passivement, en modelant leurs croyances en fonction des adultes importants (en général, les parents) qui vivent autour d’eux. Comme le dit le dicton, la pomme tombe sous l’arbre Cependant, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Les recherches que nous avons menées ne montrent pas vraiment que les enfants sont des apprenants malléables, ni que les parents jouent un rôle critique dans le façonnement des attitudes des enfants. Les enfants ne sont pas forcément de la pâte à modeler pour les parents. Peut-être que l’esprit de l’enfant est plus indépendant qu’on ne le croit.
Encore une fois, tout cela a du sens si nous considérons la race comme une émanation d’une adaptation évoluée par rapport à la vie en groupe. Les groupes sociaux font partie du paysage de nos sociétés et pour en apprendre plus sur ces groupes, il faut toujours prendre en compte le paysage global. L’enfant apprend la race en observant l’ensemble de sa communauté, pas seulement les croyances de ses parents.
Ce processus ne caractérise pas seulement la race. Les enfants des immigrants qui parlent avec un fort accent n’ont pas forcément eux-mêmes un accent aussi marqué. Pourquoi ? Parce que les enfants sont exposés à d’autres discours que celui de leurs parents. Ils écoutent le discours des autres membres de la communauté autour d’eux, même si ce discours est entendu moins fréquemment que le discours parental. Il en est de même pour les croyances raciales des enfants. Elles sont façonnées par l’environnement culturel global, à cause de la façon dont les enfants ont tendance à « écouter ». Lorsqu’un enfant apprend ce qu’est la race, il cherche à trouver de l’information qui est pertinente à la nature des différences sociales, et la culture est saturée de ce genre d’information. La plupart des renseignements qu’il trouve confirme que les différences raciales sont à la fois fondamentales et profondes. Ce n’est donc pas une surprise de voir les enfants adopter ces mêmes convictions relativement tôt dans leur apprentissage.
Regardez comment on parle des races à la télévision, qui est une source d’information que même nos enfants les plus jeunes passent du temps à « étudier ». Et pour chaque épisode du Cosby Show qu’un enfant regarde, il va aussi voir des dizaines d’annonces publicitaires pour des chaussures de sport. Ce genre d’annonce met en scène des Noirs qui ont des comportements animaux et dangereux, qui pratiquent des matchs de basketball « violents », joués sur des terrains en ville et que l’on regarde derrière des grillages. Dans ces annonces, les Blancs ont plutôt tendance à être représentés comme disciplinés, concentrés sur leurs objectifs et maîtrisant leurs émotions, ou encore courant dans un parc ou s’entraînant sur des machines rutilantes. Quel message pensons-nous envoyer aux enfants avec ce genre de contraste ?
MT : Est-ce que les Américains arrivent à dépasser ces préjugés ?
LH : Pas automatiquement. Évidemment, peu d’adultes expriment de façon aussi « brute » des attitudes négatives telles que « les Noirs sont paresseux », alors que la plupart des enfants en maternelle sont prêts à énoncer cette généralisation. Mais cela ne veut pas dire que les préjugés disparaissent lorsque nous devenons adultes : ils restent, sous des formes moins directes, moins évidentes.
Je vais vous donner un exemple tiré de l’une de mes récentes recherches. Aux États-Unis, c’est grâce à la « racialisation » de l’accès au pouvoir que l’on a maintenu des inégalités de pouvoir aux plans économique et politique. Et cette racialisation de l’accès au pouvoir était elle-même fondée sur le maintien de populations racialement distinctes, malgré les taux élevés de mixité raciale qui ont toujours marqué la réalité.
LEGENDE : Katie Heffernan, assistante de recherche du professeur Hirschfeld, teste les croyances des enfants par rapport à la transmissibilité héréditaire des caractéristiques physiques.
Pour maintenir ce concept fictif de populations racialement discrètes, une règle a été d’une importance critique : la règle de la goutte de sang, selon laquelle une personne est noire si on peut trouver une quelconque trace d’un ancêtre noir dans ses origines, si minime cette trace soit-elle. Nos recherches montrent que les enfants blancs semblent être exposés à cette règle de la goutte de sang pendant la phase intermédiaire de l’enfance [entre 6 et 8 ans]. Mais ce résultat n’est pas le plus surprenant. J’ai été sidéré de découvrir que la grande majorité de mes collègues – des gens qui auraient été outrés si je leur avais suggéré qu’ils pouvaient avoir des croyances racistes – adhéraient aussi à la règle de la goutte de sang. En particulier, quasiment tous acceptent l’idée que des traits raciaux minoritaires tels qu’une peau foncée ou des cheveux crépus puissent dominer génétiquement des traits raciaux majoritaires comme une peau claire ou des cheveux raides. Dans leur esprit, la règle de la goutte de sang est littéralement biologique.
Au départ, ce qui m’intéressait, c’était de découvrir à quel moment exact les enfants apprennent la règle de la goutte de sang, parce qu’en fait, cette règle n’a aucun fondement biologique. Génétiquement, une peau foncée n’est pas un trait dominant, par rapport à une peau claire. Et à ce sujet, le bons sens n’a aucun sens. Biologiquement, l’absurdité de la goutte de sang devient évidente quand on la reformule. Est-il vraiment raisonnable de soutenir qu’une femme blanche peut donner naissance à un bébé noir, mais qu’une femme noire ne peut accoucher d’un bébé blanc ? Non, évidemment, ce paradoxe n’aurait pas beaucoup de sens.
Bien entendu, l’utilisation sociale de la règle de la goutte de sang n’a intrinsèquement rien de raciste. Pour l’individu, c’est une manière d’affirmer son appartenance à un groupe dans un contexte à forte hybridité. Dans l’Amérique d’aujourd’hui, il existe de bonnes raisons pour qu’une personne ayant un parent noir et un parent blanc se dise Noire, surtout à un moment où la politique identitaire joue un rôle important dans la distribution de bien des ressources. L’idée clé consiste à bien comprendre que l’identité n’est pas fondée sur la biologie, en dépit de notre perception historique qui indique qu’elle l’est.
MT : Comment pourriez-vous démonter ce que vous avez appelé plus tôt « une mauvaise idée profondément enracinée » ?
LH : Mon livre est essentiellement une description détaillée des croyances des enfants sur la race, mais j’espère qu’il peut aussi nous aider à trouver des chemins qui nous permettent d’enseigner plus efficacement le sens du mot race.
Il y a deux approches. La première consisterait à enseigner la race comme nous enseignons la physique moderne. Nous n’attendons pas de nos élèves ou de nos étudiants qu’ils abandonnent leur intuition fondée sur le bon sens lorsqu’ils suivent un cours de physique, même si ce cours leur montre que le bon sens est imprécis. De fait, à l’université, nous concevons nos cours de physique précisément de telle sorte que les étudiants apprennent à raisonner sur le monde d’une manière qui peut sembler étrange par rapport au bon sens.
Corollairement, l’enseignement du concept de race doit contribuer à développer chez les enfants de nouveaux styles de raisonnement sur les différences humaines. Ce faisant, nous arriverions à montrer aux enfants dans quelle mesure le bon sens est artificiellement « pré-marqué », psychologiquement, historiquement et culturellement. Par exemple, le bon sens chez l’adulte et chez l’enfant indique que tout ce que nous avons à faire pour savoir qui est noir et qui est blanc consiste à ouvrir les yeux et regarder autour de soi. On peut aider l’enfant à remettre en question cette vision des choses en soulignant le fait qu’il y a 70 ans, aux États-Unis, les Irlandais, les Juifs et les Italiens n’étaient pas perçus comme « Blancs ». À cette époque, le terme émeutes raciales décrivait les conflits entre Blancs et Italiens ou entre Blancs et Noirs. Il est important que nos enfants comprennent que c’est la politique, pas la biologie, qui détermine qui est Blanc et qui ne l’est pas.
Une deuxième approche consiste à faire comprendre aux jeunes enfants le danger inhérent à la catégorisation raciale. Souvent, on enseigne aux enfants la race en leur disant que ce concept n’est pas très important et que les différences raciales sont superficielles. Cette façon de faire est attrayante, mais elle néglige l’importance réelle de la race pour réguler les ressources et les opportunités. La grande majorité des Blancs ne reconnaît pas à quel point le racisme envahit notre société et affecte la vie des Noirs au quotidien. C’est peut-être à cette évidence même qu’il faut sensibiliser nos enfants, au lieu de contribuer à leur cacher.
MT : On dirait que vous croyez que les adultes en ont autant à apprendre que les enfants.
LH : Fort probablement. Nous sommes encore trop peu à nous rendre compte à quel point les Américains racialisent leur environnement en associant à la race des qualités qui n’existent tout simplement pas. Nous utilisons la race pour indexer la pauvreté et certains désavantages. C’est aussi le fondement de l’action positive, aussi appelée discrimination à rebours, basée sur des critères raciaux, ce à quoi j’adhère fortement.
Le problème, c’est qu’en utilisant la race ainsi, nous risquons de croire qu’il y a vraiment une relation de cause à effet entre race et pauvreté. Nous risquons de nous cantonner à une interprétation raciale de la pauvreté parce que nous pensons que la pauvreté est souvent distribuée selon des critères raciaux. Nous pensons cela non pas parce qu’il y un lien causatif entre les critères d’appartenance à un groupe racial minoritaire et les critères de paupérisation (bien que de nombreuses personnes partagent cet avis). En fait, notre interprétation raciale de la pauvreté est causée par un enracinement si fort de la race dans notre esprit que ce sont nos capacités conceptuelles qui nous invitent à faire le lien.
La race et la pauvreté sont deux phénomènes qui ne sont pas causalement liés, contrairement à nos croyances sur la race et la pauvreté. En fait, c’est très facile pour l’esprit d’imaginer que la race peut être corrélée à beaucoup d’autres facteurs : performances athlétiques, intelligence, etc. Nous pensons ainsi, en partie parce qu’il est facile de croire que le bagage racial est transmis en bloc. Le sang noir ou le sang blanc, en tant que structure raciale génétiquement cohérente transmise par vois héréditaire, est une idée qui est généralement acceptée, mais elle ne correspond à aucune réalité. C’est pourquoi cela n’a pas beaucoup de sens d’essayer de justifier par la race la distribution d’une adaptation biologique aussi complexe que l’intelligence.
Ces gens qui acceptent l’argument de la courbe de Bell, selon laquelle la race représente une destinée biologique, ne sont pas les seules personnes qui devraient se renseigner un peu plus sur le sujet. Le gouvernement lui-même utilise le facteur race comme base de travail dans de nombreuses circonstances, de l’établissement des districts du Congrès à l’éligibilité des citoyens aux programmes de lutte contre la pauvreté. La logique de cette stratégie est la même que celle que nous avons mentionnée plus haut. La race est vue comme un indice d’un autre facteur, en l’occurrence le désenchantement politique et l’inégalité de l’accès aux ressources.
En fait, ne serait-il pas mieux de formuler la question de telle sorte qu’elle nous permettrait de trouver les vraies raisons pour lesquelles les gens subissent des inégalités, plutôt que de la passer par le filtre des catégories raciales ? Le problème, ce n’est pas l’heuristique que nous utilisons, l’heuristique consistant à réfléchir au moyen d’une ou de plusieurs stratégies servant à simplifier le monde pour mieux le comprendre. Par exemple, l’atome de Bohr (représenté par une mini-version du système solaire) était inexact, mais utile, car il a permis de faire progresser la théorie de la physique. Le problème réside plutôt dans l’utilisation conjointe de la race et d’une heuristique à la fois très séduisante et très puissante. Nous nous invitons nous-mêmes à mal percevoir le monde à travers des lunettes colorées par les races, avant de nous féliciter ensuite pour la clarté de nos perceptions.
L’utilisation de la race pour justifier les inégalités matérielles nous induit en erreur. Pire, cette stratégie sollicite nos instincts les plus bas. Parce que ces instincts sont très profonds, il est difficile pour l’esprit de voir, au-delà de l’utilisation stratégique d’une idée, ce que nous voulons vraiment savoir. Dans de nombreux domaines politiques – éducation, santé, logement –, je ne peux pas m’empêcher de croire qu’il serait préférable de résoudre les problèmes structuraux sous-jacents qui génèrent des inégalités, plutôt que de rester en superficie et se perdre dans les biais que nos outils conceptuels mettent devant nous. Ces biais ne sont pas inutiles cependant : ils peuvent nous aider à déconstruire le monde. Mais inévitablement, ils appauvrissent notre capacité à en pénétrer la structure.
Qu’est-ce que la race ? (Albert Memmi)

Définition d’Albert Memmi dans l’Universalis
« Le racisme est la valorisation, généralisée et définitive, de différences biologiques, réelles ou imaginaires, au profit de l’accusateur et au détriment de sa victime, afin de justifier une agression. Le texte suivant commente et justifie cette définition. (…)
Le mot « race » est d’emploi relativement récent dans la langue française. Il date du XVe siècle et vient du latin ratio, qui signifie, entre autres, « ordre chronologique » ; ce sens logique persiste dans l’acception biologique qui s’impose par la suite : la prétendue race est alors comprise comme un ensemble de traits biologiques et psychologiques qui relient ascendants et descendants dans une même lignée. Terme d’élevage, il est d’ailleurs appliqué à l’homme seulement à partir du XVIIe siècle »… pour ne devenir une doctrine affirmée qu’à partir du XIXe siècle.
Parler de « racisme » pour les périodes antérieures pourrait donc sembler anachronique. Néanmoins, le rejet, la domination et l’agression de l’autre, de l’étranger, du différent justement parce qu’il est différent (différence « réelle ou imaginaire », pour reprendre la définition d’Albert Memmi) sont des comportements anciens, qui remontent bien avant l’existence même du mot « racisme » dont pourtant ils relèvent déjà.
Racisme masculin
- Conviction qu’on peut catégoriser les êtres humains en une série de races en se basant sur des critères physiques mesurables, surtout quand cela s’accompagne d’une hiérarchisation, consciente ou inconsciente, entre ces prétendues races.
Le racisme est une théorie biologiquement sans fondement au stade où est parvenue l’espèce humaine, mais dont on comprend la généralisation par la nécessité, à tous les niveaux d’organisation, de la défense des structures périmées. (Henri Laborit, Éloge de la fuite, 1976)
- (Spécialement) Doctrine politique préconisant la domination d’une race (dite pure et/ou supérieure) sur les autres (dites impures et/ou inférieures).
- « Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. (…) Je répète qu’il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. »
Jules Ferry et Georges Clemenceau, débat des 28-31 juillet 1885, entre Jules Ferry, Camille Pelletan et Georges Clemenceau.
- Attitude de mépris ou d’hostilité, pouvant aller jusqu’à la violence, envers des individus en raison de leur prétendue race, de leur ethnie.
Des études montrent que, dès l’âge de 3 ans, l’enfant s’est déjà forgé des attitudes très négatives par rapport aux membres des exogroupes. Pour beaucoup, l’enfant apprend ce type d’attitude passivement, en modelant ses croyances en fonction des adultes importants (en général, les parents) qui vivent autour de lui. Comme le dit le dicton, la pomme tombe sous l’arbre. Cependant, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Les recherches que nous avons menées ne montrent pas vraiment que les enfants sont des apprenants malléables, ni que les parents jouent un rôle critique dans le façonnement des attitudes des enfants. Les enfants ne sont pas forcément de la pâte à modeler pour les parents. Peut-être que l’esprit de l’enfant est plus indépendant qu’on ne le croit.
Encore une fois, tout cela a du sens si nous considérons la race comme une émanation d’une adaptation évoluée par rapport à la vie en groupe. Les groupes sociaux font partie du paysage de nos sociétés, et pour en apprendre plus sur ces groupes, il faut toujours prendre en compte le paysage global. L’enfant apprend la race en observant l’ensemble de sa communauté, pas seulement les croyances de ses parents. »



